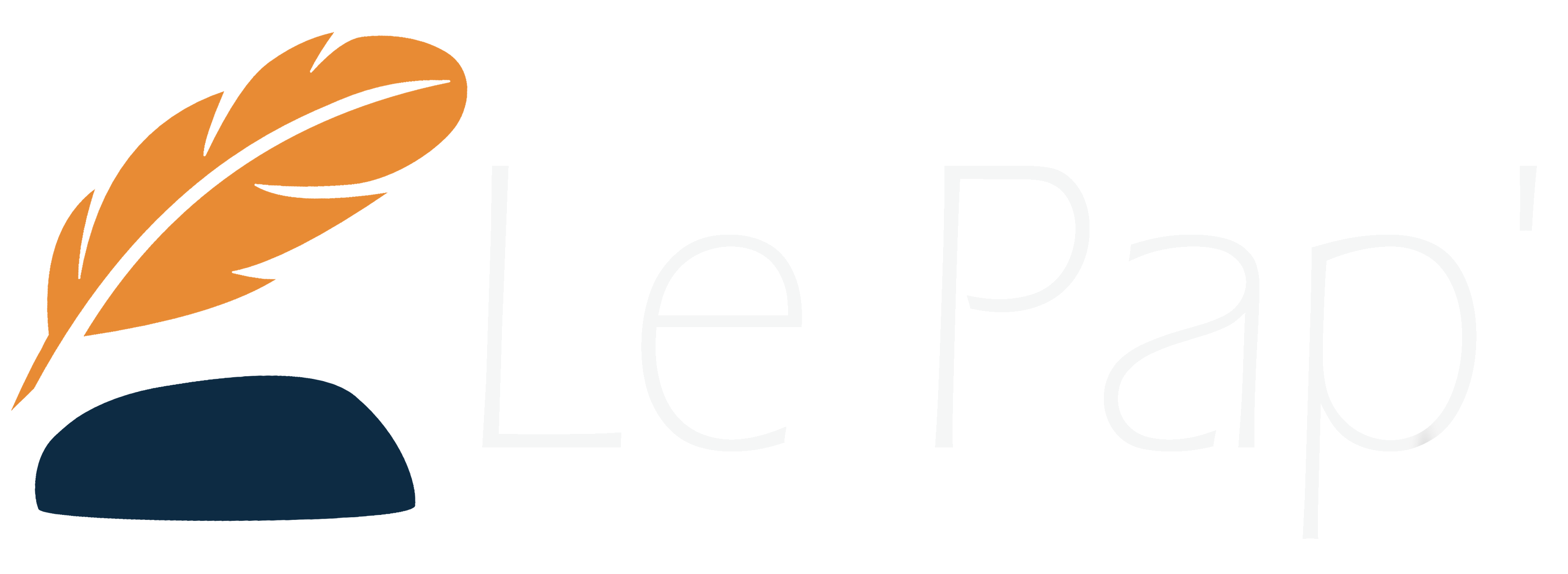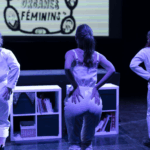Ah, le calendrier… Comment pourrions-nous nous débrouiller sans ? Mais connaissez-vous son origine ? À l’occasion de la nouvelle année, penchons-nous sur l’histoire surprenante de cet objet indispensable du quotidien !
Un calendrier… ou plusieurs ?
Vous le savez peut-être, le calendrier que nous utilisons, bien qu’étant le plus répandu, n’est pas et surtout n’a pas été le seul en usage. Aujourd’hui, la quasi totalité des pays utilisent le calendrier grégorien, au moins pour les événements civils (par opposition aux événements religieux).
Le calendrier grégorien a été promulgué par le Pape Grégoire XIII (d’où son nom) en 1582, pour remplacer le calendrier julien (de Jules César !) alors en usage. La principale conséquence de ce changement a été… la suppression immédiate de 10 jours ! Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 a tout simplement été le vendredi 15 octobre (désolée pour ceux qui fêtaient leur anniversaire dans cette “faille temporelle” !).Enfin, “suppression immédiate”… façon de parler : certains pays, certaines régions même, ont refusé pendant parfois plusieurs décennies de passer au calendrier grégorien. C’est ainsi qu’en Alsace, son adoption s’est faite progressivement sur près d’un demi-siècle, avec pendant plusieurs années, des dates différentes dans des villes voisines… À vrai dire, cette résistance à changer de calendrier est assez compréhensible : vous imaginez le chaos que cela produirait si on devait supprimer 10 jours demain; quand on a déjà du mal avec l’heure d’hiver et l’heure d’été ? À en croire les Essais de Montaigne, “c’était véritablement remuer le ciel et la terre à la fois…”
Mais pourquoi ce changement arbitraire ?
Parfois, on veut faire simple, et on finit par faire compliqué… Eh bien, c’est un peu ce qui s’est passé. Dans la Rome antique, les années avaient, au début, un nombre fixe de jours, environ 300, à peu près calés sur les cycles de la lune (ça, c’était la version simple). Cela a vite été réformé, en rajoutant des jours (pour arriver à 355) et des mois, janvier ou février, qu’on a mis au début ou peut-être à la fin de l’année, les historiens ne le savent pas vraiment. Pour pallier le décalage avec l’année astronomique, les pontifes rajoutaient de temps en temps un mois supplémentaire.
Ce système étant décidément trop compliqué – il est arrivé qu’en période de guerre, les pontifes “oublient” de rajouter le mois intercalaire – Jules César a décidé d’y mettre un peu d’ordre. Il a ramené le nombre de jours à 365 et a introduit un jour supplémentaire tous les 4 ans : c’est donc à lui qu’on doit le système des années bissextiles ! Malheureusement, l’année astronomique mesure à peu près 365,2422 jours (et des poussières) et non pas exactement 365,25 jours, ce qui occasionnait un surplus d’environ 3 jours tous les 400 ans, et donc d’une dizaine de jours au moment du passage au calendrier grégorien ! (Nous y voilà.)
Maintenant, avec la “réforme grégorienne”, les années bissextiles sont seulement celles qui sont divisibles par 4 mais pas par 100, sauf si elles sont divisibles par 400. C’est un peu compliqué, mais on a encore quelques années avant de se poser ces questions…
Les calendriers, des instruments politiques ?
Finalement, changer de système est tellement compliqué que ça peut être considéré, d’une certaine manière, comme un acte politique : non seulement on peut donner son nom au nouveau calendrier (comme Grégoire ou Jules, à tout hasard), mais cette substitution peut aussi être utilisée pour marquer, symboliquement, un “changement d’ère”. Ça a été le cas par exemple avec le fameux calendrier républicain, qui a été introduit en 1792 et appliqué pendant un peu plus de 12 ans, avant d’être aboli par Napoléon Bonaparte. Non seulement tous les mois ont été renommés (Vendémiaire, Floréal, Thermidor, … ça vous dit quelque chose ?) par un poète – véridique ! – mais l’année commençait désormais en septembre avec l’équinoxe d’automne (comme symbole d’égalité) et plus surprenant, les semaines comportaient… 10 jours ! C’est peut-être la raison pour laquelle Bonaparte n’a pas eu trop de mal à revenir au système grégorien, en rétablissant tout d’abord le dimanche à la place du “décadi” comme jour de repos pour les fonctionnaires (donc un bonus de 16 jours de repos par an environ !).
De nos jours, les systèmes autres que le système grégorien sont principalement utilisés à des fins religieuses : c’est pour ça, par exemple, que le Ramadan ne tombe pas tous les ans le même mois (le calendrier musulman, ou hégirien, fonctionne uniquement sur les cycles lunaires et ne comporte que 354 jours), que le nouvel an chinois a lieu un jour différent chaque année (même si la Chine utilise le calendrier grégorien en usage civil) ou que les fêtes de Pâques orthodoxe et catholique sont toujours décalées… les uns utilisant encore le calendrier julien, les autres le grégorien.
D’ailleurs, pour l’anecdote, on a dû attendre le XIXe siècle pour que le génial mathématicien Carl Friedrich Gauss propose une formule “simple” pour calculer la date de Pâques dans les systèmes julien et grégorien !
Cela dit, il faudra attendre un peu avant de s’inquiéter d’un nouveau changement de calendrier pour se caler sur l’année astronomique: au rythme actuel, ce sera seulement dans plus de 3000 ans que nous serons en avance d’un jour solaire.
A.W.
Sources :
Les calendriers romains
https://icalendrier.fr/calendriers-saga/calendriers/romain
Passage du calendrier julien au grégorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calendrier_gr%C3%A9gorien
Essais de Montaigne
https://babybluedog.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/09/montaigne-essais-iii-trad.pdf (voir page 301)
Calendrier républicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain#Exemple_de_calendrier_r%C3%A9publicain et https://archive.org/details/tudesrvoluti00guiluoft/page/332/mode/2up?q=d%C3%A9cadi
Algorithme de calcul de la date de Pâques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_de_la_date_de_P%C3%A2ques_selon_la_m%C3%A9thode_de_Gauss
Pays avec un autre calendrier
https://www.topito.com/top-pays-autre-calendrier
Années bissextiles