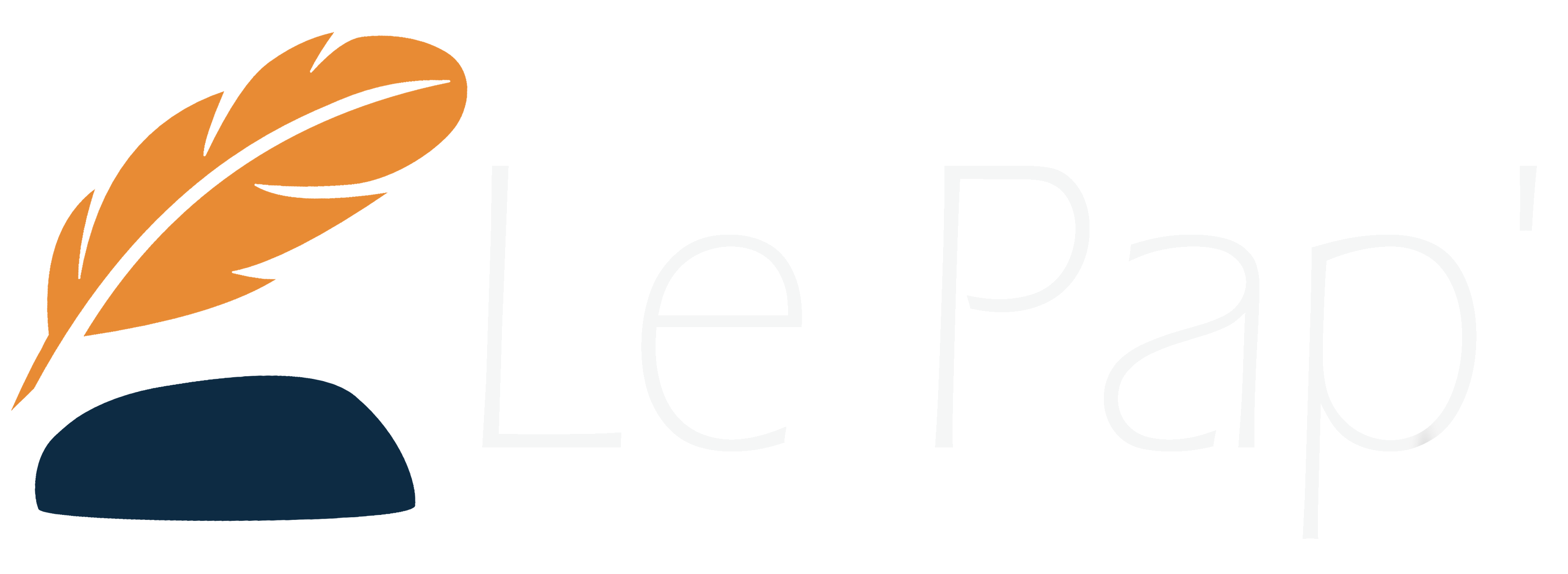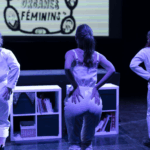Dès sa première campagne, Donald Trump a évoqué l’idée de punir ses adversaires, menaçant Hillary Clinton d’emprisonnement en 2016. En 2024, il a de nouveau promis de s’en prendre aux opposants, même au sein de son propre parti, qu’il considère comme des traîtres — notamment Liz Cheney, qui a appuyé Kamala Harris.
Trump a invité ses partisans à surveiller les bureaux de vote en 2020, instillant l’idée que l’élection serait truquée avant même qu’elle ait lieu. En refusant de reconnaître qu’il avait perdu, il a mis en doute les résultats de l’élection et a incité des millions d’Américains à croire qu’elle lui avait été volée, ce qui a encouragé la désinformation à grande échelle.
Le 6 janvier 2021, des émeutiers pro-Trump sollicités par Trump prennent d’assaut le Capitole de Washington, interrompant le vote de certification au Congrès de l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis.
Si les événements du 6 Janvier avaient choqué les États-Unis et le monde à l’époque, les traces dans l’esprit des Américains s’évanouissent aujourd’hui petit à petit. Et une majorité d’électeurs n’en ont pas tenu rigueur à Donald Trump en novembre.
Joe Biden avait toutefois appelé à ne pas « oublier » ou « réécrire » ce qui a constitué une « véritable menace pour la démocratie ».
Avec une majorité au Sénat, il procédera à un ensemble de nominations judiciaires, militaires et politiques, selon des critères moins méritocratiques et plus idéologiques. Il semble même prêt à aller tester la loyauté de sa majorité au Sénat avec des nominations vraiment préoccupantes, comme celles de Pete Hegseth comme secrétaire à la Défense, Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement et Robert F. Kennedy Jr. comme secrétaire à la Santé. Pete Hegseth s’est fait remarquer pour avoir appuyé les propos bienveillants de Donald Trump sur les manifestants suprémacistes de Charlottesville en 2017. Tulsi Gabbard estime que Bachar al-Assad, ancien dictateur de la Syrie, n’est pas un ennemi des États-Unis. « RFK Jr. » a défendu publiquement de nombreuses théories complotistes liées aux questions de santé.
Avec une majorité à la Chambre, Donald Trump pourra mettre en œuvre son programme fiscal et engager des dépenses farfelues comme l’expulsion massive d’immigrants sans papiers.
La majorité conservatrice de la Cour suprême lui a donné plusieurs victoires notables, en particulier une assez large immunité pour les gestes officiels faits lorsqu’il était — et sera — au pouvoir. De plus, bien qu’elle conserve une marge d’indépendance qui pourrait lui permettre d’entraver les excès de Donald Trump, la Cour suprême voit son rôle de contre-pouvoir miné par une légitimité populaire en berne. Elle ne semble parfois plus être un arbitre impartial, mais plutôt une institution influencée par des intérêts partisans, ce qui affaiblit sa crédibilité et remet en question son rôle dans la défense des principes démocratiques.
L’architecture institutionnelle des États-Unis n’a jamais visé à accorder un poids égal à chaque voix dans le processus décisionnel. Le système fédéral favorise les électeurs des États moins peuplés, comme le Wyoming, par rapport à des États plus peuplés comme la Californie et New York. La séparation des pouvoirs a été conçue pour limiter le pouvoir populaire, mais a parfois conduit à des excès, comme les lois Jim Crow (lois nationales et locales issues des Black Codes imposant la ségrégation raciale aux États-Unis et promulguées par les législatures des États du Sud de 1877 à 1964. Ces lois ont été mises en place pour entraver l’exercice des droits constitutionnels des Afro-Américains).
Des pratiques comme le gerrymandering (le découpage des circonscriptions électorales ayant pour objectif de donner l’avantage à un parti, un candidat ou un groupe donné) et la suppression de certains groupes d’électeurs, notamment les Afro-Américains (qui ont du mal à obtenir les papiers d’identité nécessaire), déforment encore davantage le processus démocratique. La levée des limites de financement des campagnes électorales par la Cour suprême a renforcé l’influence des grandes fortunes et des entreprises dans la politique. Par exemple, Timothy Mellon, fils d’Andrew Mellon (homme d’affaires américain, milliardaire) a contribué entre 125 et 197 millions de dollars à la campagne de Donald Trump, tandis qu’Elon Musk était le quatrième contributeur individuel.
Enfin, difficile de faire abstraction de la guerre de l’information qui a pris place avec le rôle parfois sous-estimé des médias sociaux dans la promulgation comme la circulation des idées. Cette campagne n’en a pas été exempte, avec des ingérences de puissances étrangères, mais aux côtés de ces pratiques, c’est de l’intérieur que le travail d’influence des idées s’est fait, avec notamment Elon Musk aux manettes. Collectes de données personnelles à des fins de ciblage politique, large diffusion de publicités mensongères, circulation de messages soutenant les théories du complot… autant de modes opératoires qui ont fait jouer un rôle primordial aux infox, suivant des modalités proches de Cambridge Analytica, célèbre pour avoir trempé dans la campagne de 2016.
Loin de célébrer un moment de ferveur démocratique, ces élections lèvent un peu plus le voile sur une démocratie sous attaque de l’intérieur. Cette élection n’est pas uniquement le fait de Donald Trump et de sa victoire, c’est la mise en évidence d’un état du lien social. Avant l’élection, l’Amérique était déjà profondément polarisée, divisée, habitée par la possibilité de connaître l’aventure nauséabonde d’une guerre civile. Au lendemain des résultats, cette menace existe toujours. Seulement, c’est encore autre chose qui semble s’être opérée. Cette campagne a repoussé les limites de l’impensable, miné le pouvoir des mots, octroyé toujours plus de place pour un réel à venir. Cela laisse penser qu’une nouvelle bataille commence à l’issue de cette campagne, qui rebat les cartes du lien social aux États-Unis.
M.G.
Sources :
Le Monde.fr
Wikipedia
Le Figaro
BBC
La Croix
Source de l’image : pixabay