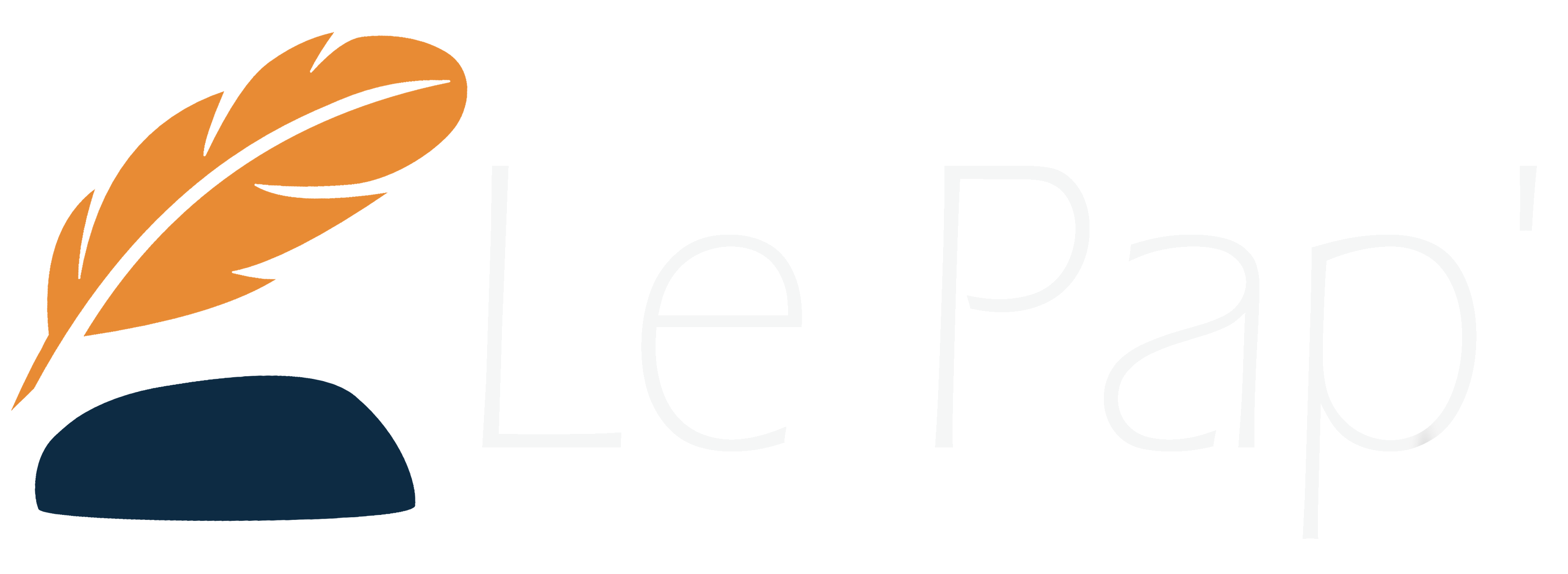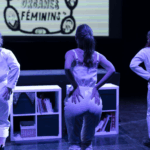Lors de son investiture le lundi 20 janvier 2025 l’ancien candidat républicain a apposé sa signature sur quarante-six documents, dont vingt-six décrets, douze mémorandums et quatre proclamations, ainsi que quatre annonces de nomination. Voici un court résumé de cet épisode.
Trump a signé un décret visant à mettre fin au droit d’asile aux États-Unis : »Nous allons mettre fin au droit d’asile, (…) ce qui crée une procédure d’expulsion immédiate sans possibilité d’asile. Nous allons ensuite mettre fin au droit du sol”, ce qui signifie que les migrants ne pourront plus demander l’asile sur le sol américain.
Un autre décret signé par le président remet en cause le droit du sol comme évoqué précédemment, un principe consacré par le 14e amendement de la Constitution américaine. Cette mesure a été suspendue par le magistrat fédéral John Coughenour qui qualifie ce décret de “manifestement inconstitutionnel“. Rob Bonta, procureur général de Californie, ajoute: «Nous demandons au tribunal de bloquer immédiatement l’entrée en vigueur de ce décret et de veiller à ce que les droits des enfants nés aux États-Unis concernés par ce décret restent en vigueur pendant la durée de la procédure». La procédure, jugée jeudi à Seattle, était portée par les procureurs généraux de quatre Etats : ceux de Washington, de l’Arizona, de l’Oregon et de l’Illinois. Ils soulignent que ce décret pourrait priver de droits 150 000 nouveau-nés chaque année, aux Etats-Unis, et risquait de rendre certains d’entre eux apatrides.
Le décret devait interdire au gouvernement fédéral de délivrer des passeports, des certificats de citoyenneté ou d’autres documents aux enfants dont la mère séjourne illégalement ou temporairement aux Etats-Unis et dont le père n’est pas citoyen américain ou résident permanent, titulaire de la fameuse « carte verte ».
L’homme d’affaires américain a aussi décrété l’état d’urgence à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et a envoyé l’armée pour surveiller et renforcer la sécurité de la frontière. Les militaires auront pour priorité « la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité des États-Unis en repoussant les formes d’invasion, y compris les migrations massives illégales ».
Il a également retiré les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, un accord international majeur visant à lutter contre le changement climatique et ayant pour but de réguler la hausse de la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés Celsius au cours du siècle.
De plus, Trump a signé un décret limitant la reconnaissance des genres à deux (masculin et féminin) et mis fin aux programmes de diversité et d’inclusion au sein du gouvernement. Lors d’un discours d’investiture, Donald Trump prononce ces mots: « à partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des Etats-Unis sera qu’il n’y a que deux sexes, masculin et féminin. »
Ces mesures prises par Donald Trump reflètent une approche plus restrictive en matière d’immigration et une réduction de l’engagement des États-Unis dans les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. On voit alors les États-Unis se diriger vers des lignes très conservatrices.
Ces décisions ont suscité de nombreuses critiques et controverses, tant au niveau national qu’international, et ont des implications significatives pour la politique intérieure (environnement, droits humains, justice sociale) et extérieure (relations internationales, répétitions, sécurités) des États-Unis. Elles soulignent également les tensions entre les priorités économiques, sécuritaires et environnementales dans la gouvernance contemporaine.
Ces mesures, dénoncées par Amnesty International, marquent un recul significatif des libertés aux États-Unis et suscitent des inquiétudes au niveau international, ces actions risquent d’aggraver les tensions sociales et de compromettre les efforts de coopération internationale en matière de climat et de droits humains.
De plus, la limitation de la reconnaissance des genres à deux sexes exclut et marginalise les personnes non-binaires et transgenres, exacerbant les discriminations et les violences à leur encontre.
Lors de son premier quadriennat Donald Trump a pu nommer un tiers des neuf juges de cette juridiction (car deux sont morts), jouant un rôle essentiel dans la vie des citoyens américains. Un rapport de force permettant, aujourd’hui, à la Cour de mener son projet de suppression du droit à l’avortement, qui renvoie à chaque Etat la possibilité d’adopter sa loi.
Ainsi Trump possède une “immunité” :
La Cour Suprême américaine a statué sur l’immunité de Donald Trump, affirmant qu’il est absolument immunisé pour les actes relevant du « cœur » de ses pouvoirs présidentiels, mais pas pour les actes privés.
Cette décision complexe crée une « zone grise » (imprécision, ambiguïté de la législation sur un cas) pour les actes dont la qualification juridique déterminera la responsabilité de Trump, influençant les poursuites en cours concernant l’élection de 2020 et d’autres accusations.
Plusieurs procès contre Trump, incluant ceux liés à des paiements secrets et à la rétention de documents confidentiels, pourraient être affectés par cette décision, avec des implications potentielles sur le calendrier des procès avant l’élection.
La décision a été accueillie avec des réactions partisanes, les républicains la soutenant tandis que les démocrates la critiquent, exacerbant les divisions politiques et l’incertitude.
M.G.
Sources :
Le Monde.fr
Wikipedia
Le Figaro
BBC
La Croix
Source de l’image : wikipedia